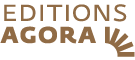Rameaux (Dimanche précédant Pâques)
Les quatre évangiles racontent l’entrée de Jésus dans Jérusalem (Matthieu 21,1-11; Marc 11,1-10; Luc 19,29-39; Jean 12,12-16). Acclamé comme un roi (ou un nouveau David), il est accueilli par des rameaux agités ou posés sur le sol. La tradition de la fête des rameaux remonte au moins au IVe siècle: les chrétiens de Jérusalem y «rejouaient» la scène, sur place, en une célébration joyeuse bientôt reprise dans tout l’Orient chrétien. À Rome, au contraire, l’accent était mis, en ce dernier dimanche de Carême, sur le mémorial de la passion.
Cette fête marque en effet l’entrée dans la Semaine sainte. C’est pourquoi, l’Église catholique romaine, après le concile de Vatican II (1962-1965), a réuni les deux dimanches des Rameaux et de la Passion en un seul.
Dans la pratique catholique actuelle, on célèbre une messe durant laquelle est lu le passage relatant cet événement dans l’un des quatre évangiles. Puis les fidèles rapportent chez eux les rameaux bénis qui, dans la croyance populaire, sont réputés assurer la protection divine sur la maison.
Pour plusieurs Églises protestantes, le dimanche des Rameaux est celui où ont lieu les confirmations ou les bénédictions de catéchumènes. Cette tradition n’a rien à voir avec l’accueil de Jésus à Jérusalem. Mais la cérémonie des Rameaux ouvre la Semaine sainte.
Vendredi saint (Vendredi précédant Pâques)
Le jour de la mort de Jésus est généralement célébré de manière sobre. Pour les protestants, il est l’occasion d’un culte dont la liturgie est marquée par les récits évangéliques de la Passion de Jésus.
L’Église catholique, quant à elle, met l’accent sur la messe du jeudi soir (en commémoration du dernier repas de Jésus). En certains endroits (comme à Romont, dans le canton de Fribourg), des processions rappellent la montée du Christ à Golgotha, alors que les cloches et les orgues des églises restent muettes en signe de deuil. Dans les églises catholiques, on parcourt le chemin de croix dont les quatorze stations évoquent les principaux événements de la Passion.
Par ailleurs, le vendredi de chaque semaine rappelle la mort du Christ, raison pour laquelle on «fait maigre» ce jour-là dans la tradition catholique.
Pâques (Dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps)
La fête chrétienne de Pâques s’est greffée sur la fête juive de la Pâque (Pessah) commémorant la libération d’Égypte. Par sa mort et sa résurrection, les chrétiens ont vu en Jésus celui qui libérait l’humanité entière, en lui apportant le salut de la vie éternelle, et ont fait de la fête de Pâques le cœur de leurs célébrations. Il est impossible de dire quand exactement la fête chrétienne a acquis son existence propre, mais il est certain qu’au milieu du IIe siècle elle était déjà la fête essentielle (voire unique) du christianisme, célébrée sous deux formes: celle, hebdomadaire, du dimanche et celle, annuelle, de Pâques.
Après de longs débats, le concile (assemblée d’évêques) de Nicée (325) a fixé la fête de Pâques au dimanche après le 14 nizan (pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps), soit entre le 22 mars et le 25 avril du calendrier romain. La mobilité de cette fête chrétienne s’explique par la différence entre le calendrier juif, qui est lunaire, et le calendrier usuel, qui est solaire. La réforme du calendrier romain (par Grégoire XIII, 1582) n’ayant pas touché bon nombre d’Églises orthodoxes, ces dernières fêtent Pâques d’après le calendrier julien.
Si la célébration religieuse de Pâques ne contient pas d’éléments agraires, des coutumes «annexes» (œufs, lapins), fort anciennes et d’origine païenne, la rattachent cependant au printemps.
L’œuf symbolise le cycle de la nature, sa renaissance, voire son immortalité. L’interdiction de manger des œufs pendant le Carême a également donné de l’importance à leur réapparition sur les tables à Pâques.
Le lapin ou le lièvre, symboles de fécondité, sont, dès l’Antiquité, rattachés à la lune dans les traditions populaires. Et la lune, qui meurt et renaît périodiquement, est aussi symbole du cycle de la nature. remarquons d’ailleurs que le mot allemand Ostern, dérivé de Ost, évoque le souvenir d’une fête pré-chrétienne du soleil levant et du printemps.